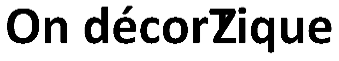Les extraterrestres ont débarqué, la Planète Bleue blêmit… Bienvenue dans Signes (Signs, 2002) de M. Night Shyamalan (prononcez “chaï-ama-lane”, ou “comme vous pouvez”, l’important c’est la peur). Après Le Sixième Sens et Incassable, James Newton Howard retrouve Shyamalan et tire l’ascèse jusqu’à l’os : un générique de 1’45’’ construit sur… trois notes. Oui, trois. Et ça suffit pour nous plier en quatre.
Ce thème, peut-être un peu moins iconique que mes précédents choix pour cette rubrique, n’est pas très long, mais il est truffé de petits détails et, comme chacun sait, le Diable se cache dans les détails.
Changes de ton !
Tout fan de Kaamelott le sait : en musique, y’a qu’un seul truc de valable, c’est juste, juste, juste, juste, just et re-juste ! Enfin, ça, c’est selon le Père Blaise (Kaamelott – Livre 2, épisode 55 : La quinte juste) qui cherche à interdire les tierces ou les sixtes et à n’autoriser, en musique, que les quartes et les quintes.
C’est de la farce pseudo-médiévale… avec un fond de vérité historique. Rappel éclair : un intervalle est la distance entre deux notes (seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave). Au Moyen Âge, on privilégiait les consonances « parfaites » : unisson, quarte, quinte, octave; tierces et sixtes paraissaient plus instables, et ne deviendront vraiment “douces” qu’à la Renaissance. Donc : Blaise exagère, mais il n’invente pas tout.
Petit rappel express (sans solfège indigeste).
Un intervalle, c’est la distance entre deux notes. On les compte en « noms de notes » :
2 noms → seconde, 3 → tierce, 4 → quarte, 5 → quinte, 6 → sixte, 7 → septième, 8 → octave.
Un ton = deux demi-tons. Un dièse monte d’un demi-ton, un bémol descend d’un demi-ton.
Diabolus in Musica
James Newton Howard resserre tout sur un motif de trois notes confié à un orchestre symphonique complet (cordes, bois — dont flûtes/piccolos —, cuivres, percussions), piano et harpes. Pas de grande mélodie qui s’étale : une idée minuscule, répétée en ostinato, que l’orchestration fait tour à tour siffler, gronder, crisser. Résultat : une machine à angoisse d’une sobriété presque insolente.
Ce thème tient sur trois notes qui enchaînent une quinte juste puis un triton (la fameuse quarte augmentée / quinte diminuée, soit 3 tons). Si tu veux une image concrète : pense par exemple Do–Sol–Sol♯ (ou Ré–La–La♯ — les hauteurs peuvent bouger, l’écart reste le même). Cette légère torsion d’intervalle déclenche une tension immédiate. À peine entendue, l’oreille sait que quelque chose cloche — exactement ce que le film promet.
Au Moyen Âge, le triton faisait grincer : on l’a surnommé diabolus in musica. Shyamalan et Howard en font un outil : ils bannissent la détente, martèlent l’ostinato de trois notes et laissent le triton mordre plus qu’il ne “résout”. Oui, Père Blaise aurait validé la quarte et la quinte, sans tierces sirupeuses. Ici, on va plus loin. La cellule pose une quinte, enchaîne avec un triton, puis insiste à nouveau sur ce triton. L’effet obtenu — ambigu, malsain, pesant — colle à la menace diffuse qui rôde, extraterrestre ou intérieure.
Et si on l’écoutait ?
Ça démarre à froid. L’ouverture repose sur un accord de trois notes, tenu aux cordes, sans mouvement. Pas d’arpège, pas de battement — un mur immobile. On entend tout de suite ce qui fera la griffe du morceau : la quinte plantée au cœur de l’accord et, dessus, le frottement qui gratte (le fameux triton dans l’ADN du tout). C’est propre, froid, volontairement “sans geste” : une dissonance horizontale qui se contente d’exister… et d’appuyer.
Ce calme est une feinte. Au-dessus de cette tenue, un timbre d’air vient se poser — mince, presque spectral — et redouble l’ambiguïté : deux hauteurs trop proches dans l’aigu, ça chauffe l’oreille sans en avoir l’air. On a l’impression de regarder un plan fixe où quelque chose bouge hors champ. La tension ne naît pas du mouvement : elle naît du refus de bouger.
Puis l’ostinato entre en scène. Là, seulement, les trois notes deviennent cellule rythmique : notes courtes, répétées, qui prennent le relais du bloc initial. Les bois ajoutent leur acidité en hauteur, un violon solo fend la surface à coups d’archet rebondissants (spiccato/ricochet) — il cisaille, il ne chante pas. Les cuivres d’abord tiennent (poids, épaisseur), puis griffent par petites figures ; parfois, des éclats glissés (harpe, clavier) font déraper le sol sous nos pieds. Tout s’organise autour de l’ostinato : il circule d’un pupitre à l’autre, chacun le relaye, le resserre, le relance.
Arrive une suspension : l’ostinato s’interrompt, l’accord redevient tenue, et l’on retrouve ce vide plein du début — ce silence qui n’en est pas un, cet arrêt qui grossit l’angoisse. On croirait un clin d’œil aux génériques “à l’ancienne” : l’image se fige une fraction trop longtemps, juste de quoi laisser remonter la peur.
La mécanique reprend, identique et pourtant déplacée : la deuxième note de la cellule s’attarde parfois, comme un hésitation insistante ; les graves rampent par demi-tons ; l’aigu se peuple de petits amas serrés. On ne quitte jamais la cage : on en change seulement l’éclairage. La densité monte brièvement — timbales qui poussent, dissonances qui se compactent — puis coupure nette. Un dernier frisson réverbère… et c’est fini. Les trois notes restent, elles, coincées dans la tête.
Et dans tout ça, qu’est-ce qu’on retient ?
Une minute quarante-cinq de tension sans vraie mélodie, c’est très rare chez James Newton Howard. Lui qui est particulièrement connu pour ses mélodies, il sort complètement de sa zone de confort et nous propose une musique minimaliste (c’était une volonté du réalisateur qui, au départ, ne voulait pas de musique dans son film). Il le dit lui-même, composer la bande originale de ce film a changé complètement sa façon d’écrire la musique.
Bien qu’il s’agisse d’un film de science-fiction, M. Night Shyamalan voulait, avec Signes, rendre un puissant hommage aux films de suspens (en particulier à Alfred Hitchcock). Et les références sont légions, parfois jusqu’à reproduire carrément des plans de Psychose, Les oiseaux, Sueurs froides ou encore La mort aux trousses. Par conséquent, il n’est pas surprenant de constater que la bande originale de James Newton Howard rend également un vibrant hommage aux partitions de Bernard Herrmann.
Le film s’ouvre par un générique à l’ancienne (le genre avec les noms de l’équipe qui s’affichent à l’écran). On n’est donc pas encore dans l’histoire lorsque l’on entend ce thème pour la première fois et Howard nous plonge directement dans cette tension souhaitée avec son thème intense et incisif, en référence à Psychose qui démarrait de la même manière. Ce procédé permet au spectateur d’imaginer le pire avant même que l’histoire ne démarre. Et ce, de manière totalement inconsciente. Le motif relayé par les différents instruments de l’orchestre est une référence à La mort aux trousses. On notera au passage que le moment de calme au milieu du thème arrive au moment où le nom du compositeur s’affiche à l’écran. C’est ce qu’on appelle, dans le jargon, une signature.
La répétition du motif nous maintient dans un état d’alerte, crée en nous une sensation d’enfermement, comme les personnages du film le seront lors du climax (ils se retrouvent barricadés dans la maison alors que les extra-terrestres rodent à l’extérieur et cherche une entrée). L’ostinato représente les crop circles qui apparaissent partout dans le monde et les extra-terrestre qui peuvent surgir n’importe où et n’importe quand. Ils sont partout, tels ces trois notes qui passent d’un instrument à l’autre.
Le personnage principal joué par Mel Gibson, un révérend, a perdu la foi à la suite du décès de sa femme dans un accident de voiture. Il vit dans sa ferme avec son frère (Joaquin Phoenix) et ses deux enfants. Des crop circles apparaissent dans son champ de maïs en même temps que sur le reste de la planète. Durant le long-métrage, le motif de trois notes n’intervient pas uniquement durant les apparitions des extra-terrestres. Même, certaines de leurs apparitions les plus intenses sont dépourvues de ce thème. On ne peut donc pas parler d’un thème lié aux extra-terrestres. Il s’agit plutôt d’un thème lié au personnage principal qui doit lutter contre ses propres démons. Et là, l’utilisation de l’intervalle du Diable (Diabolus in Musica) prend un tout autre sens. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction standard et les extra-terrestres ne sont pas la principale menace de l’intrigue.
En somme, le fameux “less is more” n’est pas un slogan, c’est une méthode. Trois notes, une quinte qui ouvre, un triton qui mord, et l’obstination qui fait tout le travail. Avec presque rien, Howard obtient tout : une identité immédiate, une tension durable, et un générique qui imprime la rétine autant que l’oreille. On peut débattre de la filmographie, mais ce Main Titles figure clairement parmi ses bandes originales les plus marquantes – et l’une des leçons de musique de film les plus nettes des années 2000.